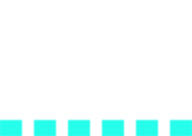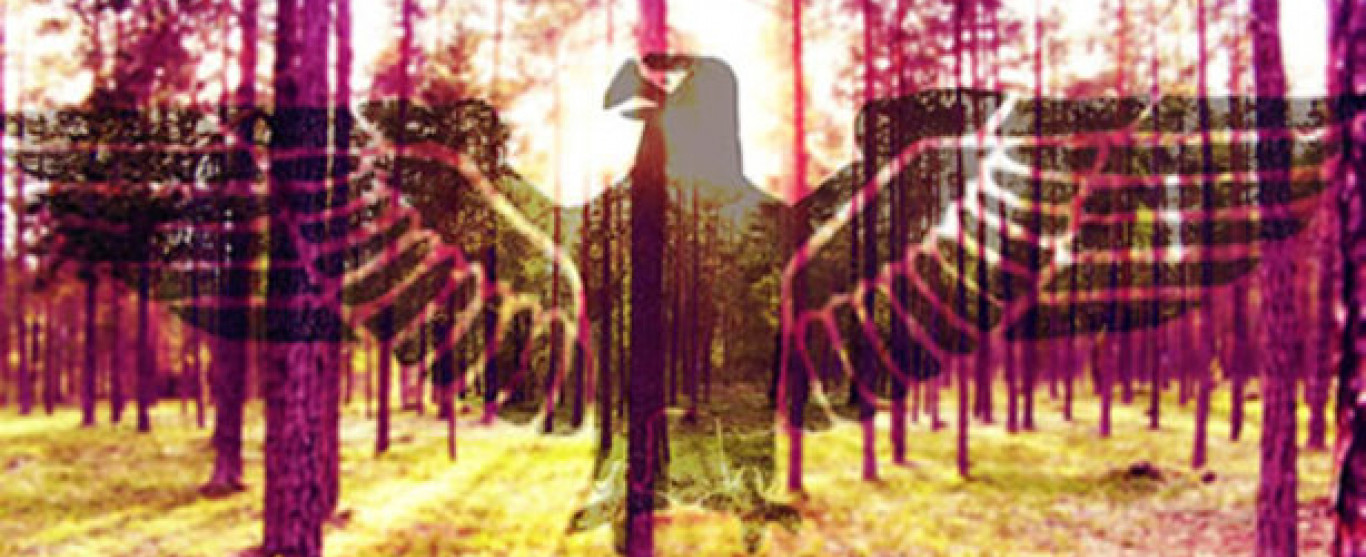Québec, réveille!
C’est la fin des classes. Les étudiants sont enfin libres. Dans un champ, trois d’entre eux fêtent le début des vacances, une bière à la main, en admirant la nature suédoise. Entre deux bousculades, leur conversation s’englue dans des propos dangereux. Une idéologie prônant un peuple homogène, une race pure, se faufile dans leur discours. Ils se saluent, le bras tendu vers le ciel, un geste banal qui donne froid dans le dos. Arrive Karl, d’origine asiatique et adopté par une famille aisée. Il se rend à son chalet pour festoyer aussi avec ses proches. Seulement, lui s’apprête à manger du chevreuil, et non des saucisses à hot-dog achetées avec ses quelques cennes. Les autres l’attendaient…
D’un côté, il y a ce groupe convaincu par la pensée hitlérienne et de l’autre, cet individu ouvert à la différence et surtout, au dialogue. Pour écrire cette pièce, Lars Norén se serait inspiré d’un fait vécu1 qui raconte le sort d’un jeune garçon battu à mort, parce qu’il aurait refusé de prononcer l’affirmation « j’aime les nazis ». Pour cette production, la version originale, intitulée Kyla, a été modifiée à quelques égards. D’abord, le texte a été adapté en langage québécois. La familiarité des expressions est d’autant plus choquante, puisqu’on reconnaît la forme que prennent les bribes d’ignorance et de préjugés que l’on peut entendre ici, au quotidien. De plus, la compagnie a décidé que le personnage d’Anders serait interprété par une femme pour montrer que la violence n’est pas une question de genre, mais qu’elle peut se trouver en chaque être humain.
Peu importe que le dénouement de l’intrigue nous soit connu, on se laisse emporter par les tensions entre les personnages, se demandant sans cesse si l’acte fatal sera commis. Figés sur nos sièges, on confronte la violence, impossible de ne pas la voir, ne pas en être atteint, ne pas tenter de la comprendre.

Crédit photo: Cath Langlois - https://www.flickr.com/photos/50973761@N08/with/32811941361/
Dès le départ, une dynamique violente est palpable entre les membres du groupe. Ils se poussent et s’insultent sans remords, au contraire, pour eux, agir ainsi est naturel. Comment faire autrement quand la vie t’a seulement appris les abus et les coups? En effet, au fur et à mesure que les dialogues s’enchaînent, on se rend compte que les trois jeunes proviennent de milieux défavorisés et que leur condition les fait souffrir. On comprend aussi que Keith, celui qui domine les deux autres, est intelligent et possède un esprit critique, toutefois, il met ses aptitudes au service d’une idéologie raciste. Alors que l’on se sentait agressé par leurs moqueries et leurs taloches, voilà qu’une forme de compassion à leur endroit nous envahit. Une envie soudaine d’aller leur parler afin qu’ils réalisent que l’énergie dépensée à détruire les autres, ils pourraient s’en servir pour se construire eux-mêmes. Leur existence est douloureusement vide. Ne sachant pas comment la combler, ils déversent la faute sur l’étranger, s’acharnent contre la différence. En pensant sauver la « race » blanche, ils se perdent eux-mêmes. Les regarder se gaspiller ainsi est troublant. Puis, surgissent l’impuissance, la colère et les larmes devant leur aveuglement inconscient, à un point tel que l’envie d’applaudir à la fin du spectacle se fait discrète. À vrai dire, on n’ose pas, la réalité et la fiction se chevauchant de trop près dans nos esprits. La pièce creuse des zones grises qui obligent à se repositionner à tout moment. Et les questionnements traversent aussi les consciences des personnages, notamment lorsque Keith s’aperçoit que son geste arrive à la limite du non-retour, il hésite. Tout n’est pas blanc ou noir.
Au début, les répliques ou les références semblaient surlignées, voire exagérées. Surtout le salut d’Hitler qu’ils exécutent, fiers et droits. Pourtant, chaque fois, la mémoire nous rappelle que cet extrait de l’Histoire se répète dans la nôtre, pas plus tard que le mois dernier, dans le quartier voisin. Certaines réalités, bien qu’elles existent, ne sont pas pour autant vraisemblables dans notre conception du monde. Alors, comment fait-on pour écrire, mettre en scène et interpréter un tel degré de violence et ne pas tomber dans le cliché, pour ne pas que le spectateur décroche de la tension qui le lie au spectacle? Olivier Lépine a su garder une simplicité nécessaire dans sa mise en scène (le propos est suffisamment chargé!) en y ajoutant une pincée d’ingéniosité. L’utilisation de la peinture blanche est judicieuse; elle contamine, devient le sang, tâche autant les agresseurs que la victime. L’interprétation est libre, et cette abstraction, bien qu’elle soit minime, est précieuse, permettant à notre esprit de baisser les gardes un instant, entre deux coups de poing.
Quant au jeu des comédien.ne.s, ils sont tous convaincants. Ne suffisait que de voir leur regard pour se sentir perturbé, particulièrement celui d’Ariane Bellavance-Fafard, chargé d’une rage brute et aveuglée.
En sortant de la représentation, les réflexions fusent et le trouble persiste. Comment faire pour casser le cycle de la violence? Quoi dire pour taire les blagues « inoffensives »? Comment briser l’ignorance? Pourquoi la haine est si contagieuse?
C’était le début des vacances et la liberté leur était promise, mais l’étaient-ils vraiment, libres?
1 La brute qui pleure, FROID de Lars Norén, document pédagogique, 2016, p. 3, [en ligne]. http://www.premieracte.ca/media/documents/78_FROID-DocumentPeIdagogique.pdf